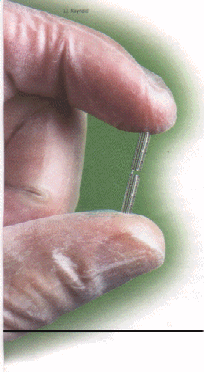 Un
grand pas vers les prothèses bioactives
Un
grand pas vers les prothèses bioactives
GREFFAGE ÉLECTROCHIMIQUE DES POLYMÈRES
Grâce à des techniques spécifiques de greffage
de polymères sur des surfaces, il devient possible de fabriquer des implants
vasculaires capables de relarguer progressivement un médicament anti-rejet.
La prothèse "bioactive" est pour demain...
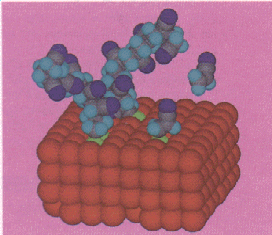
Des liaisons à toute épreuve.
Les monomères en gris, mis au contact de la pièce, occupent les
sites métalliques disponibles vert et donnent naissance a de longues
chaînes polymères.
E n 1999, a travers le monde, un million de patients victimes d'athérosclérose seront opérés: un "stent", minuscule cylindre métallique, sera glissé dans l'artère défaillante. puis élargi pour obliger cette dernière à reprendre son diamètre normal. Le bénéfice à court terme sera spectaculaire mais à plus longue échéance, dans 30% des cas au moins, une abondante prolifération cellulaire viendra à nouveau rétrécir l'artère, imposant par fois une nouvelle intervention fort risquée. Les médicaments capables de bloquer ce mécanisme biologique existent. Mais ils doivent être pris en continu et à doses élevées après l'intervention, avec des risques liés aux effets secondaires. Ce constat a conduit une équipe tripartite (université de Giessen en Allemagne, INSERM Bordeaux et CEA de Saclay) à lancer un programme de recherche sur une prothèse bioactive. capable de fixer une substance organique, puis de la relarguer localement pendant quelques jours à plu sieurs mois. Lune des étapes-clés était la fixation de molécules organiques à la surface des implants; c'est à ce stade qu'est inter venu le groupe CSI du CEA.
"Nous travaillons depuis près de 15 ans sur les interactions entre surfaces minérales et substances organiques. explique Christophe Bureau, son responsable. Ces dernières années, l'exploration du greffage de polymères par électrochimie nous a permis d'obtenir des revêtements d'une solidité et d'une durabilité exceptionnelles. C 'est ce capital qui a été mis à disposition de nos partenaires."
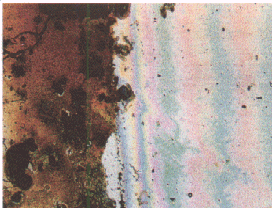
Un revêtement
haute densité
Le polymère
ordinaire greffé
sur la parie droite
ne cette pièce
métallique protège presque
totalement contre
la corrosion.
Le secret de ces revêtements inédits réside - entre autres - dans l'utilisation de monomères, plutôt que de polymères en solution quand la surface métallique est parcourue par un courant, ces monomères viennent occuper les sites métalliques disponibles, puis ser vent d'amorce à de longues chaînes polymères. Les liaisons chimiques sont Si fortes qu'aucun test de traction n'en vient à bout : la colle reliant la machine de traction au polymère casse avant! Et la densité d'accrochage est telle qu'un polymère dépourvu de propriétés anti-corrosion intrinsèques mais greffé selon cette méthode, protège un métal ordinaire contre les ambiances salines les plus agressives.
Autre atout. décisif dans le cas du stent qui est ajouré à
40% : une épaisseur de revêtement régulière et
maîtrisée à quelques dizaines d'angströms près.
Aucune des autres techniques essayées par le laboratoire ne permettait
un contrôle aussi précis... Quant au relargage, il peut être
provoqué par des variations de pH ou par d'autres "déclencheurs"
moléculaires. de manière naturelle ou grâce à
des médicaments sans effets secondaires.
Plusieurs années ont été nécessaires pour sélectionner des monomères. des solvants et des supports d'électrolyse biocompatibles. puis pour ajuster les conditions expérimentales. La collabo ration avec l'INSERM Bordeaux a porté également sur la fixation de la molécule active : celle-ci est encagée dans des liposomes. eux- mêmes fixés sur le polymère greffé en surface.
Des tests in vitro sur des porcs, ont prouvé la biocompatibilité des prothèses ainsi recouvertes de films de polymère obtenus par greffage électrochimique. Le brevet commun déposé en novembre dernier ouvre donc de vastes horizons : au-delà des stents, il s'applique à toutes les prothèses biomédicales.