Pourquoi avoir recours au clonage moléculaire?
En clonant des gènes d'intérêt dans des systèmes biologiques adéquats, on se donne les moyens de produire différentes catégories de protéines recombinantes (ou encore hétérologues).
I. Définition:
Les protéines hétérologues sont produites soit par des cellules, soit par des organismes entiers tels que des animaux, des plantes, auxquels on a transféré le(s) gène(s) codant pour ces protéines. Ces organismes sont dits transgéniques, produits par "gene-farming" pour les animaux, et "molecular farming" pour les végétaux.
II. Les catégories de protéines recombinantes:
- A usage thérapeutiques: médicaments (hormone de croissance, insuline, tpa ...), vaccins (hépatite B, grippe).
- Enzymes: industrie laitière (chymosine), industrie de l'amidon (alfa amylase), autres.
III. Problèmes de fabrication traditionnelle des médicaments:
1- Quantité disponible:
Traditionnellement, il s'agit d'extraire des protéines d'intérêt pharmacologique de liquides biologiques (plasma, sang, urines), d'organes humains ou animaux. Le problème est que la quantité ainsi disponible est limitée et dans la plupart des cas insuffisante.
2- Contaminations par des virus infectieux:
- les virus HBV, HCV, l'hépatite non A non B, le HIV sont impliqués. La technique solvant-détegent remplace à l'heure actuelle le chauffage du sang pour éliminer ces virus.
- La maladie de Creutzfeld-jacob est causée par un prion, qui est un agent transmissible responsable d'une encéphalopathie spongiforme mortelle: les neurones se raréfient, présentent des vacuoles dans leur cytoplasme. Les prions résistent aux procédés d'élimination des virus. On ne peut pas les détecter. La seule solution de les déceler est d'injecter du matériel à tester sur des souris ou des hamster.
3- Modification de la protéine au cours de son extraction:
Elle peut alors devenir inactive ou antigénique.
I
V. Les systèmes cellulaires de production:Il y a toujours un couple cellule hôte + vecteur d'expression (plasmidique ou viral) adapté à la cellule hôte.
1- Choix des hôtes cellulaires:
Il dépend de l'utilisation ultérieure de la protéine hétérologue.
a) S'il s'agit d'une protéine d'eucaryote supérieur, dont on veut tester l'activité biologique, on n'en a pas besoin d'une grande quantité. On va préférer l'expression transitoire du gène en question dans des cellules de mammifère.
b) On veut beaucoup de protéine recombinante pure. On évalue les différents systèmes d'expression cellulaire possibles et on sélectionne le plus performant. Ces systèmes sont fonction de la protéine en question; les trois systèmes opérationnels actuellement sont la levure, le colibacille, la cellule de mammifère.
c) Si les protéines doivent subir des modifications post-traductionnelles pour assurer leur activité biologique, on ne peut utiliser E. Coli qui, en tant que procaryote, en est incapable. Si la modification post-traductionnelle est une glycosylation, on ne peut employer la levure car celle-ci les effectue de manière incorrecte pour les pauvres eucaryotes que nous sommes. Il faut utiliser ds cellules de mammifère.
Il n'y a pas d'hôte idéal, il dépend de la protéine à produire. On emploie cependant préférentiellement le colibacille dès que cela est possible.
2- Choix du vecteur d'expression:
Un vecteur doit posséder un promoteur, des régions régulatrices de transcription, des signaux d'initiation et de fin de traduction, éventuellement des signaux de secrétion. Il doit être stable. Si la protéine est d'usage thérapeutique, il convient de disposer d'un promoteur fort produisant une grande quantité d'ARNm.
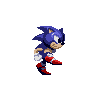 | Entretien avec Axel Kahn: les risques du clonage |
| Entretien avec Axel Kahn: les risques du clonage | ![]() Les techniques de clonage
Les techniques de clonage